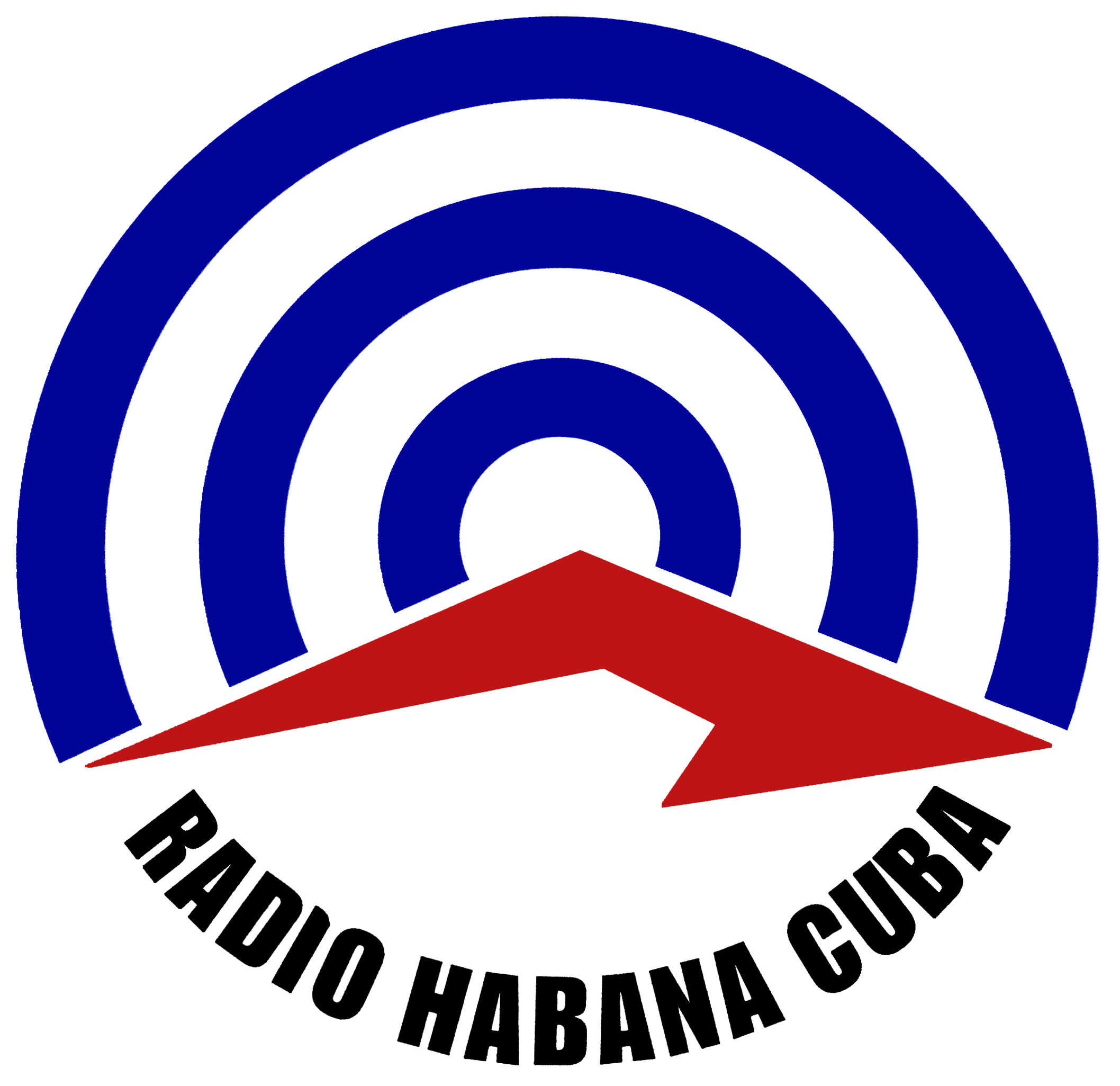La Havane, 10 octobre (RHC) Cuba commémore aujourd’hui le début des guerres d’indépendance contre le colonialisme espagnol, marquées par le Grito de Yara, mené par Carlos Manuel de Céspedes le 10 octobre 1868.
Ce jour-là, dans sa propriété de La Demajagua, à l’est du pays, l’avocat Céspedes revêtit l’habit du libérateur et entama le chemin tortueux qui fit de lui un Père de la Nation.
Ce matin-là, il rassembla d’autres insurgés cubains, accorda la liberté à leurs esclaves et les invita à affronter l’armée espagnole, tout en remettant le Manifeste de la Junte révolutionnaire de l’île de Cuba.
Avec votre héroïsme, je compte sur l’accession à l’indépendance. Avec votre vertu, je compte sur la consolidation de la République. « Vous pouvez compter sur mon altruisme », déclara-t-il, donnant ainsi le coup d’envoi de la guerre de 68, la Grande Guerre, ou guerre de Dix Ans (ainsi nommée en raison de sa durée).
Ses paroles devinrent un cri de guerre anticolonialiste, antiesclavagiste et de libération nationale cubain.
« Lorsqu’un peuple atteint l’extrême dégradation et la misère où nous nous trouvons, personne ne peut lui reprocher de prendre les armes pour échapper à un État aussi honteux », déclara-t-il après avoir énuméré les problèmes du pays.
La crise mondiale et ses conséquences ici, les différences économiques entre les régions cubaines, le refus de l’Espagne d’accorder le droit de réunion, la liberté de la presse, la formation de partis politiques et l’abolition de l’esclavage furent parmi les causes du déclenchement.
Le Cri de Yara, qui résonna dans le reste du pays, est considéré par les historiens comme un triomphe des idées indépendantistes sur le fondamentalisme espagnol et les mouvements réformistes et annexionnistes de l’époque.
Ce fut le début de la première guerre d’indépendance cubaine contre l’Espagne, qui suscita et réveilla le patriotisme, tant chez les esclaves, les paysans, les artisans, les professions libérales que chez les intellectuels.
Mais ce ne fut pas la seule : après de nombreuses effusions de sang, l’Espagne conserva le contrôle de l’île en 1878, grâce au soutien de l’oligarchie esclavagiste, et l’objectif d’émancipation de la majorité des Cubains resta insatisfait.
Suivent ensuite la Petite Guerre (1879-1880) et la Guerre d’Indépendance, ou Guerre Nécessaire (1895-1898), cette dernière organisée par le héros national José Martí, et dont le succès fut contrarié par l’intervention du gouvernement des États-Unis.
À la fin du XIXe siècle, Cuba passa des mains de l’Espagne à la tutelle des États-Unis, et une nouvelle histoire commença pour ses enfants.
Source Prensa Latina