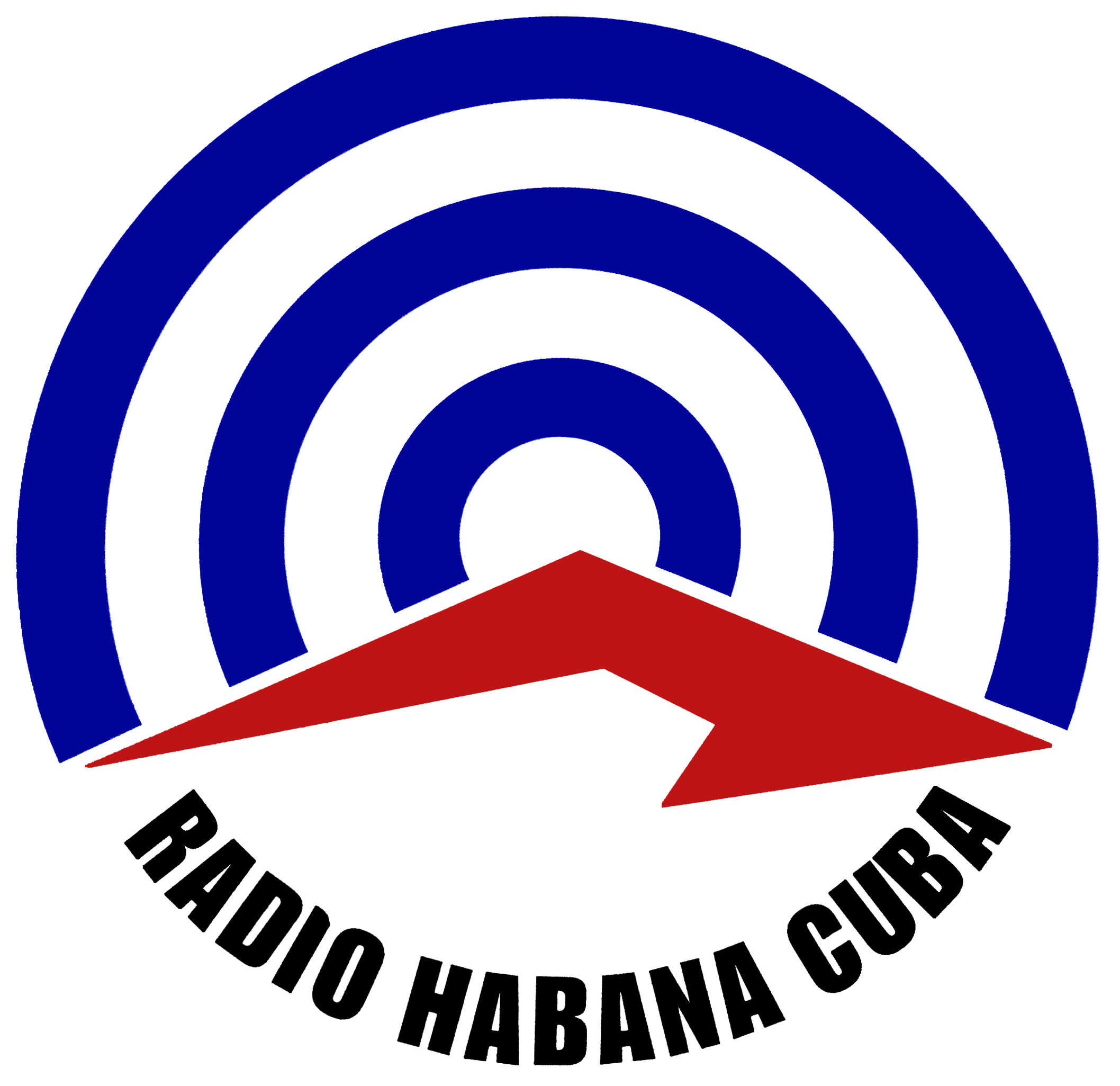Par : René González Barrios
« Tous les Cubains étaient persuadés que le gouvernement américain leur apporterait un soutien effectif dans leur quête de liberté… » C’est ainsi que le général Enrique Collazo, de l’Armée de libération, l’exprimait dans son ouvrage *Les Américains à Cuba*, évoquant la tristesse et la désillusion que l’intervention impériale de 1898 avait engendrées chez le peuple cubain.
Trente années de lutte acharnée contre le colonialisme espagnol avaient fait naître l’espoir d’une « aide sincère » de la part d’une « démocratie », idéalisée et amplifiée par la presse de l’époque, comme modèle socio-économique et politique. Dans l’imaginaire collectif, l’image des États-Unis comme nation abolitionniste, où existaient des institutions « démocratiquement » élues, la « liberté de la presse » et une économie florissante, prévalait. C’est peut-être cet attrait qui, dans un premier temps, a conduit nos libérateurs de 1868 à éprouver respect et admiration pour leur voisin du Nord et ses institutions.
Le 10 avril 1869, à l’Assemblée de Guáimaro, l’assemblée constituante cubaine approuva à l’unanimité la proposition d’annexion présentée par le peuple de Camagüey. À cette époque, ce dernier recherchait l’aide américaine à tout prix. Le 7 février 1870, constatant l’indifférence et le mépris des Américains pour la cause de l’indépendance, Céspedes écrivit dans un Manifeste au peuple cubain :
« …Lorsque Cuba s’est engagée dans l’arène de la lutte, lorsqu’elle a déchiré avec vaillance le manteau de la monarchie qui emprisonnait ses citoyens, elle n’a pensé qu’à Dieu, aux hommes libres de toutes les nations et à sa propre force. Elle n’a jamais imaginé qu’un étranger puisse envoyer des soldats ou des navires de guerre pour conquérir sa nationalité… »
Plus clairement, fin juillet 1870, il écrivait à José Manuel Mestre à New York : « …En ce qui concerne les États-Unis, je me trompe peut-être, mais à mon avis, leur gouvernement aspire à s’emparer de Cuba sans complications dangereuses pour la nation, et, dans l’intervalle, à l’empêcher de quitter le contrôle de l’Espagne, ne serait-ce que pour devenir une puissance indépendante ; c’est là le secret de sa politique, et je crains fort que tout ce qu’il fait ou propose ne vise à nous occuper et à nous empêcher de rechercher d’autres alliés, plus efficaces ou plus désintéressés.»
Deux ans plus tard, la mission diplomatique cubaine aux États-Unis, alors dirigée par Ramón Céspedes Barrero, fut rappelée. Dans une lettre qui lui était adressée le 30 novembre 1872, il écrivait :
« …Il nous était devenu impossible de supporter plus longtemps le mépris avec lequel le gouvernement des États-Unis nous traitait, un mépris qui s’accroissait à mesure que nous faisions preuve de patience. Nous avons trop longtemps joué le rôle de mendiants à qui l’on refuse sans cesse l’aumône et à qui l’on claque finalement la porte avec insolence. (…) Nous ne devons pas perdre notre dignité simplement parce que nous sommes faibles et malheureux. »
Le général Calixto García Íñiguez, désabusé comme Céspedes, écrivait le 4 juillet 1874 : « J’ai reçu aujourd’hui du courrier de Cuba et de la Jamaïque. Tous deux affirment avec certitude que les États-Unis nous reconnaîtront bientôt. J’espère que cela se confirmera, bien que j’en doute, car les Américains n’ont jusqu’ici guère montré d’intérêt pour le sort de notre pauvre patrie… »
La guerre contre l’Espagne révéla le vrai visage de ce puissant voisin, et les coups portés par les États-Unis forcèrent les libérateurs à revoir leur position. Les États-Unis étaient le principal fournisseur d’armes, de logistique et de financement du régime espagnol à Cuba ; les poursuivants acharnés des expéditions Mambí ; les geôliers des révolutionnaires cubains, sauvagement harcelés par leurs services de police et leurs services secrets ; l’ignorance perpétuelle des gouvernements de la République de Cuba en matière d’armement ; et les facilitateurs, dans le dos de Cuba, de son acquisition par l’achat et la vente.
À mesure que la Guerre nécessaire progressait, dès 1897, le mouvement indépendantiste considérait l’entrée en guerre des États-Unis avec une certaine naïveté, voire une forme de résignation. L’espoir d’une aide véritable subsistait, alimenté par la presse américaine, critique de la puissance espagnole sur l’île et, accessoirement, propagandiste des succès des Mambí. Chez les libérateurs, la perception des États-Unis évoluait au gré de la manière dont la guerre et ses événements révélaient les véritables intentions de ce puissant voisin. Le 31 décembre 1895, le général Bernabé Boza, chef d’état-major du général en chef Máximo Gómez, écrivait dans son journal de guerre :
«…Et les Yankees hésitent encore à reconnaître notre belligérance ! (…) Il semble que les fils de l’Oncle Sam nous joueront, dans cette guerre, le même rôle qu’en 1868. Qu’importe ! Notre gloire n’en sera que plus grande, car le monde entier verra Cuba indépendante grâce à l’effort unique et au courage indomptable de ses fils.»
Le chevaleresque général Serafín Sánchez, ami de Gómez et Martí, tombé le 18 novembre 1896 à la bataille de Paso de las Damas, dans la région de Sancti Spíritus, avait une vision plus lucide de ce puissant voisin : «…Pauvre Cuba, ma patrie, aux mains des États-Unis, ses fils, une petite et insignifiante fraction, seraient anéantis et réduits à l’état d’hilotes sur leur propre terre, s’attirant le mépris de la race saxonne divinisée et la considération de leur propre peuple.»
Le 19 avril 1898, le Congrès de l’Union approuva la Résolution conjointe. Son texte dissipa tout doute quant aux véritables intentions américaines : « …le peuple de l’île de Cuba est, et doit être, libre et indépendant.» Le lendemain même, les États-Unis déclarèrent la guerre à l’Espagne. Du jour au lendemain, les persécuteurs des révolutionnaires, les ennemis de la pleine indépendance de l’île, se montrèrent soudainement coopératifs et bienveillants. Des expéditions chargées de vivres et de matériel américain, composées de patriotes cubains bloqués depuis des mois aux États-Unis et de volontaires américains escortés par des navires de guerre américains, débarquèrent sur les côtes de l’île, apportant tout ce qui leur avait été refusé pendant trente années de harcèlement et d’hostilité.
Entre juillet et août 1898, soldats cubains et américains combattirent ensemble contre les troupes espagnoles.
Un élan d’héroïsme se manifesta. Mais on constatait aussi des signes de despotisme au sein du commandement nord, une application arbitraire des décisions, des manifestations de chauvinisme et de racisme, et, à plusieurs reprises, un mépris pour les opinions et l’expérience des dirigeants cubains. Dans un article publié dans Military Review et intitulé « Opérations conjointes et combinées lors de la campagne de Santiago de 1898 », le lieutenant-colonel Peter S. Kindsvatter, de l’armée américaine, reconnaît que : « …le général García était de moins en moins sous les feux de la rampe au fil de la campagne ; Shafter n’autorisa donc pas les Cubains à participer aux négociations et ne les invita pas à la cérémonie de reddition. En fait, ils n’eurent pas le droit d’entrer à Santiago, soi-disant pour éviter tout risque de violence et de pillage.
Tout aussi insultante pour les Cubains fut la décision de Shafter de maintenir les fonctionnaires espagnols à leurs postes gouvernementaux – des fonctionnaires que les Cubains avaient tenté d’expulser pendant trois années de combats. Le mépris de Shafter – et de la plupart des Américains – pour les Cubains transparaît dans cette lettre à sa mère : « L’armée n’a guère de compassion pour les Cubains. Nous n’avons rencontré ici que des Noirs sales et détestables qui mangent nos rations, refusent de travailler et refusent de se battre. » Kindsvatter conclut en reconnaissant : « …une campagne qui avait débuté sous le signe de la coopération de tous les participants s’est soldée par des querelles mesquines et de l’amertume.»
SOURCE : CUBADEBATE