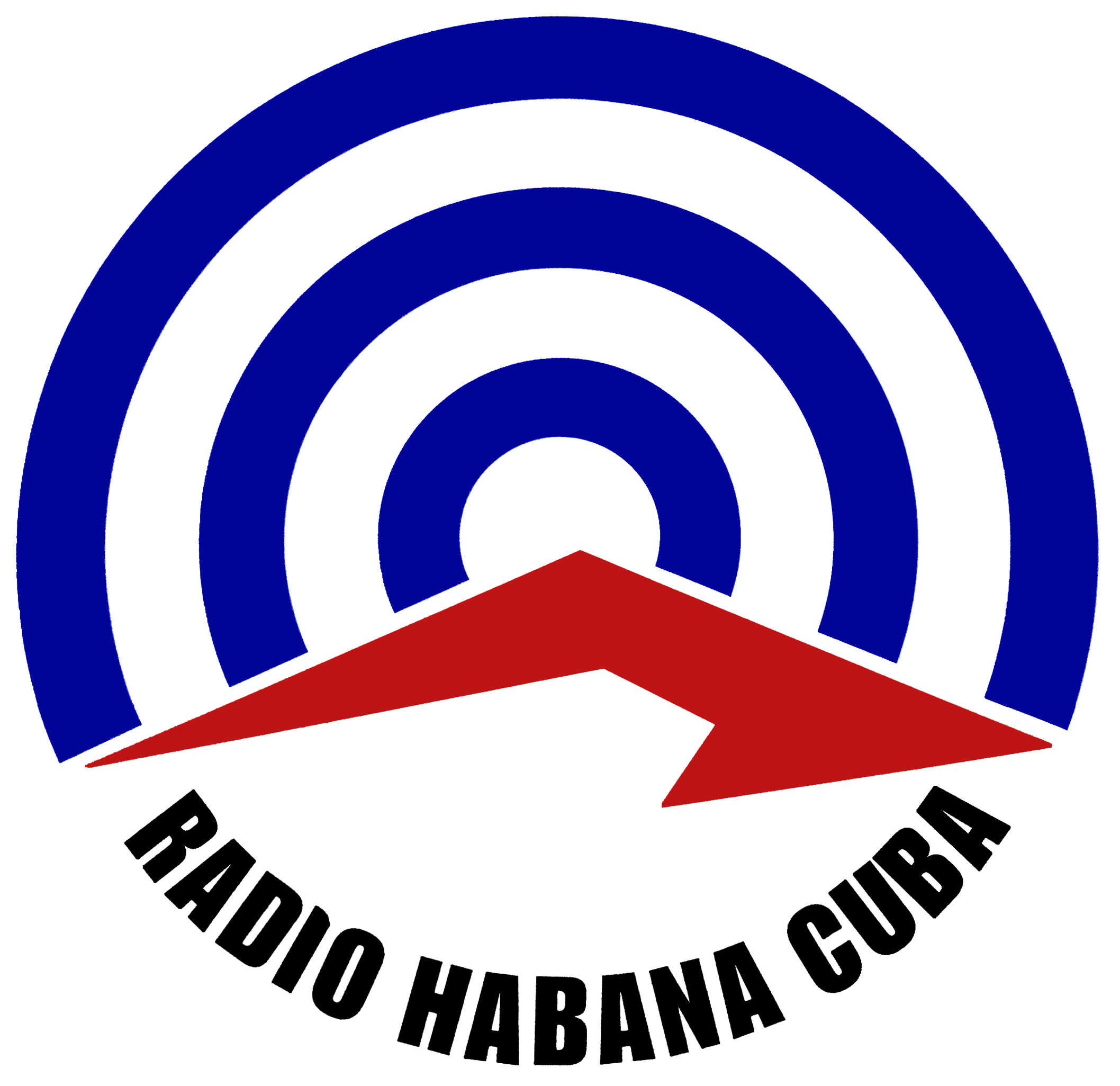D’un point de vue historique, il serait difficile de comprendre pourquoi De Soto ne lui obéit pas, car il n’a laissé aucune trace écrite des raisons de sa contradiction avec sa souveraine. Cependant, son désir de partir au plus vite pour l’expédition qu’il préparait pour la conquête de la Floride, qui prit la mer un an seulement après sa nomination et deux ans après son mariage avec Doña Inés de Bobadilla, a pu influencer sa décision. C’était un homme impatient, en effet.
Après la catastrophe que l’attaque pirate perpétrée en 1555 par le corsaire français Jacques de Sores avait provoquée dans la ville de San Cristóbal, et dans laquelle le gouverneur de l’époque, Pérez de Angulo, avait joué un rôle si honteux[1], la Couronne décida que Cuba n’aurait plus jamais de gouverneurs civils et envoya le capitaine Don Diego de Mazariegos remplacer Angulo, décédé, avec l’ordre de construire une nouvelle forteresse, mieux située et mieux équipée pour la défense de la ville.
Ce n’est pas un hasard si Mazariegos était un militaire chevronné. Il accepta avec urgence la suggestion de la reine Juana à De Soto et, outre la supervision de la construction du Château de la Force Royale, il fit ériger une tour de guet de 12 mètres de haut sur le rocher d’El Morro, en pierre blanche qui brillait sous la lumière tropicale et était visible à huit lieues à la ronde. Cette tour, en plus d’abriter des sentinelles qui surveillaient constamment la côte, servait de guide aux navires approchant de San Cristóbal. À son insu, il conçut le bâtiment qui deviendrait plus tard le phare d’El Morro, mondialement connu comme l’emblème de La Havane.
Avant d’aborder ce château, il est nécessaire de consacrer quelques instants à une brève biographie de son architecte en chef, qui fut également l’architecte de la forteresse de San Salvador de La Punta. Maître Bautista Antonelli [2] était membre d’une famille italienne de sept architectes civils, hydrauliques et militaires de grand prestige. Ils ont servi quatre monarques espagnols pendant 90 ans, laissant derrière eux d’importantes œuvres en Espagne même, au Portugal, en Afrique du Nord et dans les colonies espagnoles des Caraïbes.
El Morro ou le Titan des Tempêtes
L’ingénieur royal Bautista Antonelli fut le constructeur des châteaux de San Salvador de La Punta et des Trois Saints Rois Mages d’El Morro.
Le Conseil des Indes le choisit, avec le maréchal Juan de Texeda, pour élaborer un plan de fortification garantissant la sécurité des ports espagnols des Caraïbes. Tous deux arrivèrent à La Havane en 1539 pour commencer les travaux d’El Morro et de La Punta et pour achever la Zanja Real, le fossé royal chargé d’amener l’eau à la ville.
À peine arrivé, Antonelli eut deux idées qui témoignent clairement de sa lucidité d’architecte militaire. La première consistait à comprendre l’importance capitale de la colline de La Punta, dont il déclara que son propriétaire posséderait le château d’El Morro, et que celui qui posséderait la colline de La Cabaña posséderait la ville. La seconde consistait à fermer l’entrée du port avec une chaîne de poutres épaisses reliées par des goujons de fer, la même chaîne qui figure parmi les symboles des armoiries originales concédées par la Couronne à la ville de San Cristóbal.
Malgré son prestige et le fait qu’il fût l’un des architectes préférés de Philippe II, le séjour d’Antonelli à La Havane fut loin d’être agréable. Comme d’autres avant lui, il fut victime d’intrigues et de manigances de hauts fonctionnaires de la ville. Il développa également une maladie de peau au visage, probablement due à l’exposition au soleil. Face à ces deux situations, il demanda au roi l’autorisation de rentrer en Espagne, faute de quoi les fonctionnaires seraient tenus de le laisser travailler en paix sans interférer dans ses décisions. La première requête fut rejetée, mais l’ordre de respecter ses souhaits fut donné au gouverneur qui le harcelait, et s’accompagna d’une augmentation de salaire significative pour le pétitionnaire. Le neveu d’Antonelli, Cristóbal de Roda, travailla avec lui comme assistant ingénieur. Ils conçurent et construisirent non seulement les deux forteresses, mais travaillèrent également aux plans de la nouvelle église paroissiale, à l’aménagement de San Cristóbal comme ville, et formèrent techniquement le personnel qui transforma la ville fondatrice, parsemée de cabanes du XVIe siècle, en la cité des maçons du siècle suivant. Il mourut en Espagne.
Les premiers travaux de construction d’El Morro commencèrent en 1589 et se heurtèrent aux mêmes difficultés que celles qui avaient entravé la construction de la Fuerza Vieja et du château de La Real Fuerza : pénurie d’argent, de matériaux et de main-d’œuvre, ainsi que détournement de ressources par de hauts fonctionnaires coloniaux. Ce n’est que sous le mandat du gouverneur Pedro Valdés (1600-1607), celui qui collabora le plus étroitement avec Antonelli, que les voûtes furent fermées et la plateforme achevée, sur laquelle fut installée une batterie de 12 canons, connue sous le nom des Douze Apôtres. Sous le gouverneur suivant, les quartiers des troupes, les dépôts de munitions, les citernes et les écuries furent achevés. La date officielle d’achèvement de ce château fut fixée à 1630.
La forteresse était conçue en forme de polygone irrégulier, avec des murs de 3 mètres d’épaisseur et de profonds fossés, ce qui en fait un exemple d’architecture militaire de la Renaissance. Certaines parties de sa structure sont inaccessibles jusqu’à une hauteur de 18 mètres.
Le château s’avance dans la mer à un angle aigu, où se dresse un demi-bastion surmonté d’une tour-lanterne de 10 mètres de haut. De là, une structure en terrasses de 150 mètres de profondeur se déploie jusqu’à relier la forteresse à la terre ferme, où elle est protégée des attaquants potentiels par deux puissants bastions. La défense extérieure qui accompagne le front comprend le fossé, conçu sans eau et très profond pour empêcher le passage ennemi ; la contrescarpe, un mur opposé au mur abrupt du château, avec le fossé comme intermédiaire ; une route couverte ; le terrain naturel immédiatement adjacent à la contrescarpe, parallèle à la ligne de front terrestre, délimité et protégé par une avant-cour, puis par un parapet, pour l’alignement des troupes et des fusiliers ; la glasis, un terrain en pente continue qui renforce le retranchement, rend difficile la descente dans les douves et dissimule la structure aux regards des attaquants. Avec la forteresse de San Salvador de La Punta, la forteresse d’El Morro a coûté 700 000 ducats au Trésor public espagnol, soit le double de la somme estimée d’après les plans originaux réalisés à Madrid.
El Morro ou le Titan des Tempêtes
Jusqu’à la construction de la forteresse de San Carlos de La Cabaña, El Morro était le principal rempart de la ville contre ses assaillants. Pendant des siècles, ses remparts ont résisté aux ravages d’une mer déchaînée lors des nombreux cyclones qui ont frappé la ville.
Elle a également résisté avec succès aux attaques des corsaires hollandais, français et anglais pendant plus de 100 ans. À propos de sa performance lors de la prise de La Havane par les Anglais en 1762, le célèbre architecte cubain Joaquín Weiss écrivit dans son traité essentiel, *L’Architecture coloniale cubaine* :
Elle résista au siège de la flotte de l’amiral Pocok – la plus redoutable flotte opérant aux Indes à l’époque coloniale – pendant quarante-quatre jours. Pour être capturée, il fallut que les Anglais, après une longue et sanglante opération de sape, dynamitent le bastion extérieur et y pénètrent par La Cabaña.
Les Anglais, qui avaient débarqué à Cojímar, envoyèrent une partie de leurs troupes à Guanabacoa, où ils se heurtèrent à la résistance acharnée du célèbre Pepe Antonio, commandant les habitants locaux. Ils envoyèrent également une autre partie sur la colline de La Cabaña, encore non fortifiée. De là, ils creusèrent des tunnels pour atteindre El Morro, introduisirent des explosifs dans la brèche et dynamitèrent une partie des murs, accédant ainsi à la forteresse, dont ils n’auraient jamais pu prendre autrement, car elle était pratiquement imprenable compte tenu des capacités militaires de l’époque.

El Morro, ou le Titan des Tempêtes
En 1763, après la rétrocession de La Havane à l’Espagne en échange de la cession de la Floride à l’Angleterre, les ingénieurs militaires de la Couronne entreprirent la reconstruction de la forteresse, endommagée par l’attaque anglaise. Au cours des trois années suivantes, et plus tard, de 1766 à 1771, le corps du bâtiment fut transformé par la création d’un nouveau système défensif tactique, qui adapta ses aspects formels et fonctionnels aux nouvelles exigences imposées par l’industrie de l’armement et aux méthodes établies par les normes de défense des forteresses du XVIIIe siècle.
De nouveaux espaces fonctionnels furent créés, permettant une plus grande capacité pour les plates-formes, les batteries, les caves à provisions, etc., ce qui permit à la forteresse de résister à un long siège et de maintenir une garnison de plusieurs centaines d’hommes.
Le volume de la construction fut augmenté, augmentant la hauteur et l’épaisseur des surfaces des bastions, des plates-formes et des parapets, avec leurs meurtrières, créneaux et bancs respectifs, afin d’assurer une meilleure protection des soldats. Les guérites furent de nouveau placées aux angles des bastions ; le fossé fut approfondi et élargi, augmentant la hauteur du rideau de terre ; la contrescarpe fut améliorée, le parapet du chemin de ronde fut surélevé et, sur la place d’armes, un petit logement pour le corps de garde fut construit.
À l’intérieur de l’enceinte, où le bombardement anglais avait détruit les bâtiments résidentiels, un énorme bloc de pierre monolithique antidéflagrant fut construit, entouré d’étroits sentiers de patrouille au sol pavé et rainuré pour le drainage des eaux pluviales.
Au sud, face à l’entrée principale de la forteresse, un espace fut construit à des fins militaires, ecclésiastiques et domestiques. Deux bastions, un autre chemin couvert, des citernes, des casernes, des cachots et d’autres entrepôts furent ajoutés, s’adaptant toujours aux caractéristiques accidentées du terrain. De nouveaux accès furent tracés à l’est, avec des chemins couverts reliant la Cabaña, la batterie de la Pastora et le fort San Diego [3]. Cette ligne défensive était positionnée sur la seule partie du terrain d’El Morro que l’ennemi pouvait attaquer.
La tour d’origine, haute de 10 mètres, initialement connue sous le nom d’El Morrillo, abrita la première lanterne à bois jusqu’au XVIIe siècle. Au début du XIXe siècle, elle fut éclairée au gaz, puis au pétrole. Cette structure fut finalement démolie et, en 1845, le Corps royal des ingénieurs érigea à sa place le phare actuel, « fait de solides pierres de taille », baptisé en l’honneur du gouverneur O’Donnell. Ses murs épais, hauts de 2,3 mètres à la base, sont percés de quatre fenêtres qui assurent la ventilation et la lumière. De forme circulaire, son diamètre diminue progressivement de la base au sommet, atteignant une hauteur de 33 mètres. Il est divisé en deux sections : la première mesure 23 mètres de haut, l’autre est surmontée d’une corniche où la lanterne et le dôme reposent sur une balustrade en fer. Le phare a été électrifié en 1945. Sa lumière atteint une portée d’environ 29 kilomètres et continue aujourd’hui encore de guider les navires naviguant près du port d’origine de Carenas.
Aujourd’hui, le Castillo de los Tres Santos Reyes Magos (Château des Trois Rois Mages) d’El Morro, la construction militaire la plus emblématique de Cuba, forme un ensemble architectural avec la forteresse de San Carlos de La Cabaña. Après sa restauration en 1986, le château a été intégré au Parc historique militaire de Morro-Cabaña, avec La Cabaña.
Aujourd’hui, elle abrite un vaste musée historique présentant une précieuse collection d’objets et de documents datant des « Grands Voyages », à commencer par les grandes expéditions maritimes entreprises par l’Espagne et le Portugal aux XVe et XVIe siècles, puis par la période coloniale. (Gina Picart Baluja)
RSL
______________________________________
[1] Cependant, Pérez de Angulo a accompli de belles choses durant son mandat. C’est lui qui a validé l’ordonnance royale dissolvant les encomiendas, mettant fin à l’esclavage des peuples autochtones de Cuba. Quant à sa fuite de la ville en présence de Jacques de Sores, si elle était due à la lâcheté que l’histoire lui attribue, on peut se demander pourquoi il a rassemblé un groupe de défenseurs parmi les habitants de Guanabacoa et est revenu à leur tête pour affronter les pirates. Quoi qu’il en soit, San Cristóbal ne disposait d’aucun moyen réel, ni avec ni sans Angulo, pour vaincre les vandales de Sores.
[2] Le constructeur de nos deux forteresses ne s’appelait pas Juan Bautista, une confusion due à la répétition des mêmes noms sur trois générations d’une même famille, dont il était le cadet de deux frères. Autre précision importante : il semble que celui qui a conçu les forteresses ou leurs plans originaux était l’architecte en chef du roi, et ce à Madrid, sous l’œil vigilant du roi Philippe II. Antonelli a peut-être participé ; peut-être a-t-il simplement apporté les plans à La Havane et travaillé, en les respectant autant que possible. Ce qui est certain, c’est que c’est lui qui a dirigé la construction.
Source Portal del Ciudadano de La Habana