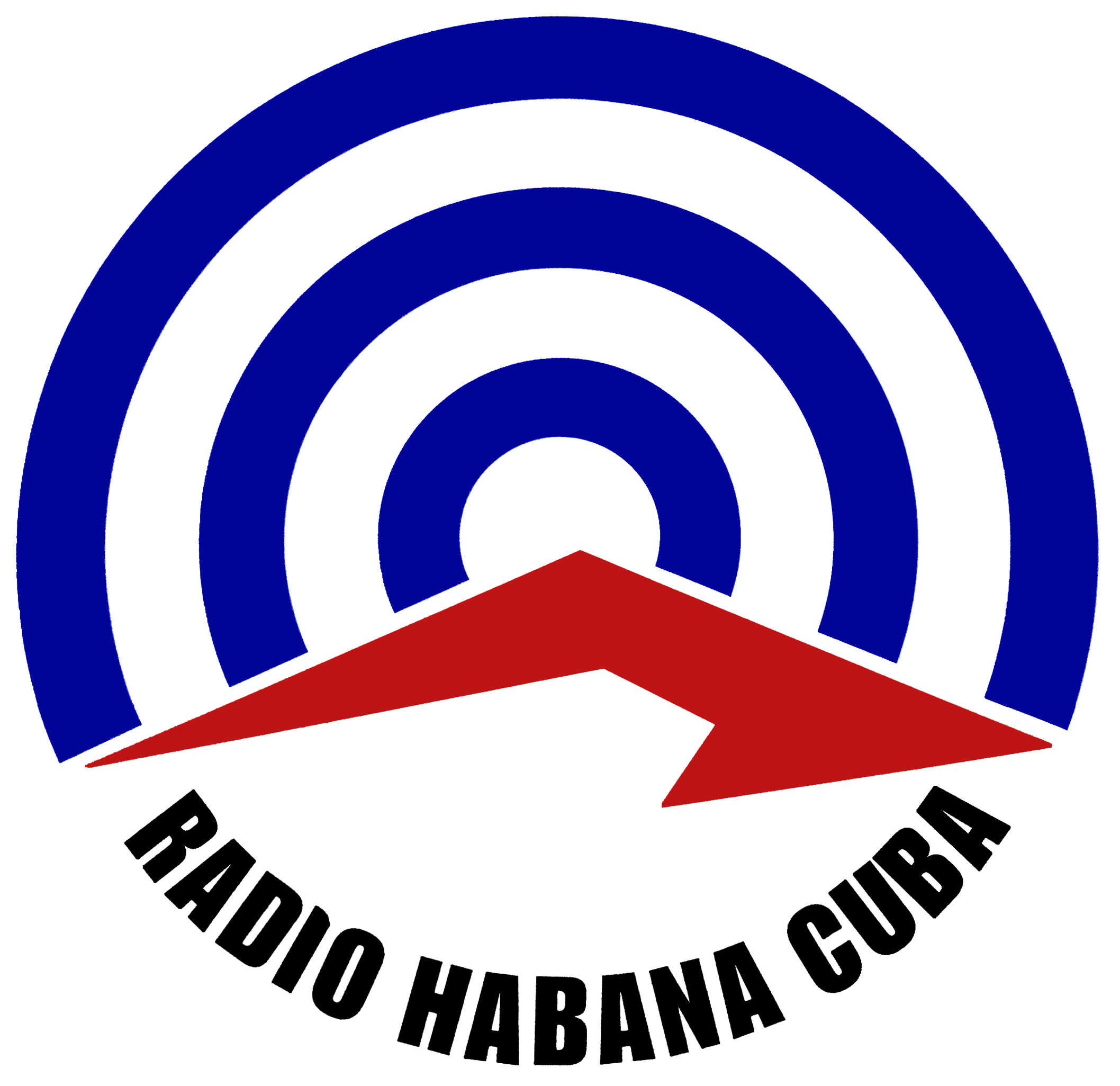Ferme Demajagua, située à Manzanillo. Photo : ACN.
Le 10 octobre 1868, avec la proclamation menée par Carlos Manuel de Céspedes dans sa ferme Demajagua, située à Manzanillo, débuta la première guerre d’indépendance de Cuba, une lutte qui dura dix ans. Comme on le sait, le grand objectif ne fut pas atteint à cette époque ; cependant, cette date et ce processus marquèrent profondément la nation cubaine, qui, au cours de cette décennie, mûrit et consolida son sentiment national. Ce processus est connu sous le nom de Guerre de Dix Ans ou Grande Guerre, par comparaison avec celles qui suivirent. Cependant, José Martí a toujours qualifié cet événement de révolution, ce qui est fondamental.
Les événements du 10 octobre se sont déroulés dans un contexte favorable à une telle déclaration. Malgré des opinions divergentes quant au moment de l’insurrection, les circonstances de l’époque ont créé un climat très particulier.
La frustration des tentatives réformistes, manifeste dans l’issue de la Junte d’information en Espagne (1866-1867), a renforcé la solution indépendantiste. Des événements tels que l’apparition d’un portrait lacéré de la reine ibérique et d’une carte de l’Espagne représentée par un âne sur le terrain de l’Université royale et littéraire de La Havane dans les années 1960 témoignaient déjà d’un état d’esprit qui allait se renforcer encore davantage au sein des groupes conspirateurs, à mesure que des groupes indépendantistes se formaient dans tout Cuba, bien qu’ils soient plus importants dans les régions orientales et centrales de l’île.

Par ailleurs, la conspiration indépendantiste qui s’exprimerait par le Cri de Lares du 23 septembre 1868 prenait forme à Porto Rico. La métropole devenait de plus en plus vulnérable, comme l’illustrait la Révolution de Septembre, ou Glorieuse, tandis que l’Amérique latine traversait des processus de réformes libérales et un sentiment croissant de rejet de l’Espagne pour ses tentatives de reconquête.
Ces facteurs ont créé un climat favorable à la déclaration d’indépendance cubaine, même si le moment de leur déclaration n’était pas convenu parmi les conspirateurs. Comme chacun sait, Carlos Manuel de Céspedes défendait le principe d’immédiateté, et ce, compte tenu des circonstances qui lui étaient favorables. L’élan historique avait indéniablement permis à Céspedes de comprendre que le soulèvement ne pouvait être retardé, tout en reconnaissant que certaines circonstances avaient accéléré l’action.
Ces groupes étaient principalement composés de propriétaires fonciers et de professionnels d’origine régionale, ce qui a influencé leurs points de vue sur la question la plus controversée : la date de son déclenchement. À cela s’ajoutèrent des divergences de vues sur l’importance de l’événement, les forces en présence et, en particulier, leur attitude envers le système esclavagiste.
Le 10 octobre 1868, Céspedes proclama l’indépendance, mais un autre geste allait marquer une vision de transformation au sein de la société : la proclamation de la liberté de ses esclaves et l’appel à lutter pour l’indépendance sur un pied d’égalité. Ce fut un coup dévastateur pour le système esclavagiste.
La vie dans les campagnes de Cuba libre marqua également un changement majeur. Comme Martí l’a décrit lors de sa conférence au Steck Hall du 24 janvier 1880, la vie quotidienne des habitants des zones dominées par les Mambises a connu des changements fondamentaux :
(…) des enfants naissaient, des femmes se mariaient, des hommes vivaient et mouraient, des criminels étaient punis, des villes entières étaient fondées, des autorités étaient respectées, des vertus étaient développées et récompensées, des défauts particuliers apparaissaient, et de longues années s’écoulaient sous le régime de leurs propres lois (…) qui créèrent un État, devinrent des coutumes (…) [qui] ancrèrent tout ce qui existait et éveillèrent dans une grande partie de l’île des loisirs, des croyances, des sentiments, des droits et des habitudes (…).[1]
Martí a ainsi décrit la transformation que cet exploit a produite dans la vie de tous ceux qui vivaient sur son territoire. Ce changement s’inscrivait dans la proclamation de la République par l’Assemblée de Guáimaro, mais aussi dans la manière dont différents groupes sociaux s’entremêlaient dans la lutte ; un élément crucial dans une société marquée par l’esclavage.
Martí a ainsi décrit la transformation que cet exploit a entraînée dans la vie de tous ceux qui se trouvaient sur son territoire. Ce changement s’inscrivait dans la proclamation de la République par l’Assemblée de Guáimaro, mais aussi dans la façon dont différents groupes sociaux se sont imbriqués sur le champ de bataille ; cet aspect revêt une importance capitale dans une société marquée par l’esclavage.
À cet égard, le processus de radicalisation qui a eu lieu durant ces années est crucial. Si le leadership initial était concentré entre les mains des propriétaires terriens du centre-est, la majorité des combattants étaient composés de classes moyennes – dont des intellectuels –, de paysans et d’esclaves libérés dans les zones de guerre, qui, grâce à leurs performances, ont gravi les échelons militaires et acquis une reconnaissance populaire. La décision de Céspedes, alors président, d’abolir l’esclavage allait marquer un moment de profonde radicalisation.
Le processus décrit succinctement n’était pas exempt de contradictions qui ont influencé le cours du conflit. Mais le changement qu’il a entraîné fut très significatif, car Cuba ne serait plus jamais la même, car, comme l’a également affirmé Martí, après une révolution, un peuple ne peut plus être le même qu’avant.[2]
La proclamation du 10 octobre 1868 marqua donc le début de ce processus révolutionnaire, au cours duquel de nouveaux symboles fondamentaux pour la nation cubaine apparurent, comme son hymne national, aux côtés de figures emblématiques comme Carlos Manuel de Céspedes, Perucho Figueredo, Ignacio Agramonte, Máximo Gómez, Antonio Maceo et bien d’autres, parmi lesquelles figurait également la présence féminine généralement symbolisée par Mariana Grajales.
Malgré les contradictions qui ont affecté le déroulement de cet exploit, obligeant d’autres à reprendre le flambeau qu’ils avaient abandonné, las de l’effort initial, ceux qui avaient le moins besoin de justice,[3], selon Martí, la Révolution de 68 s’avéra un événement fondamental pour la consolidation de la nation et pour de nouveaux projets révolutionnaires. Le 10 octobre marqua sa naissance, son moment fondateur.
[1] José Martí : Œuvres complètes. Centre d’études martiniennes, La Havane, 2002, édition numérique, vol. 4, p. 195.
[2] Ibid., p. 109
[3] Ibid., vol. 4, p. 273
Source Cubadebate