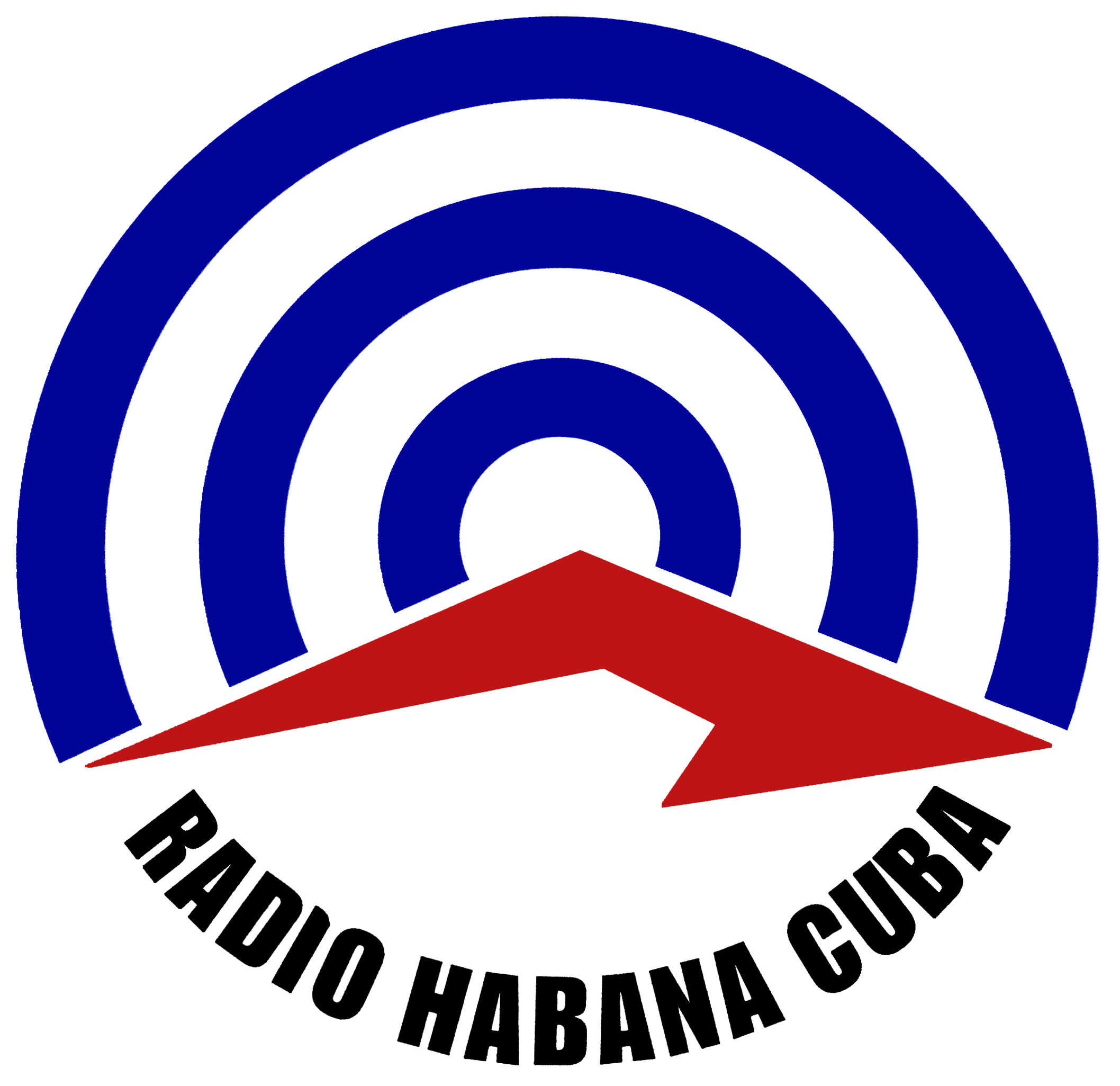L’aube du 10 octobre 1868 marqua le début de la grande lutte de Cuba pour la liberté et l’indépendance. Ce jour-là, Carlos Manuel de Céspedes libéra non seulement ses esclaves, mais les appela également à se joindre à la lutte pour briser le joug colonial espagnol à Cuba.
Voici comment notre héros national, José Martí, décrirait les événements de cette aube glorieuse de 1887 :
« Les plus purs mystères de l’âme s’accomplirent ce matin-là à Demajagua, lorsque les riches, se débarrassant de leur fortune, partirent se battre, sans haine pour personne, pour la dignité, qui vaut mieux qu’elle : lorsque les maîtres des hommes, à l’aube naissante, dirent à leurs esclaves : “Vous êtes libres !” Ne ressentez-vous pas, comme moi, le froid de cette aube sublime ?… Pour eux, pour eux, tous ces encouragements que ce glorieux souvenir vous apporte ! Merci en leur nom, Cubains qui n’avez pas honte d’être fidèles à ceux qui sont morts pour vous : merci en leur nom, Cubains qui ne vous lassez jamais d’être honorables !…
Dès ces premiers instants, les aspirations cubaines se heurtèrent non seulement à la puissance espagnole sur cette île des Antilles, mais aussi à Carlos Manuel de Céspedes, le chef suprême de la révolution naissante, comprit que la prise de Cuba était le secret de la politique américaine.
Dans une lettre adressée à l’homme politique américain Sumner, Céspedes expliqua son opinion à ce sujet :
« La nation américaine, qui a sympathisé avec tous ceux qui ont lutté pour la liberté et même noblement aidé certains, ne peut que sympathiser avec Cuba, comme l’ont démontré les nombreuses et enthousiastes expressions de divers organes d’opinion publique. » Il appartiendra à l’histoire impartiale de juger si le gouvernement de cette République a été à la hauteur de son peuple et de la mission qu’il représente en Amérique, ne restant plus un simple spectateur indifférent des barbaries et des cruautés perpétrées sous ses yeux par une puissance monarchique européenne contre sa colonie, laquelle, exerçant son droit, rejette sa domination pour accéder à l’indépendance (à l’instar des États-Unis), mais apportant au contraire un soutien matériel et moral indirect à l’oppresseur contre les opprimés, aux forts contre les faibles, à la monarchie contre la République, à la métropole européenne contre la colonie américaine, aux esclavagistes récalcitrants contre le libérateur de centaines de milliers d’esclaves.
Le rebelle cubain, cependant, a su définir la relation entre le gouvernement et le peuple des États-Unis : « Mais cela n’a pas diminué l’estime du peuple cubain envers les États-Unis. Les deux sont frères et restent unis par l’esprit malgré la conduite de l’administration de ces derniers, qu’il ne m’appartient pas de décrire.»
Et Céspedes, reconnu comme le Père de la Patrie cubaine, scellerait pour l’histoire sa foi en l’indépendance : « Quoi qu’il en soit, que ce jour arrive ou non, la vigoureuse Révolution cubaine est déjà immortelle ; la République vaincra la monarchie ; le peuple cubain, plein de foi en son destin de liberté et animé d’une persévérance inébranlable sur le chemin de l’héroïsme et du sacrifice, sera digne d’être nommé, maître de son destin, parmi les peuples libres d’Amérique. »
« Notre devise est et sera toujours : l’indépendance ou la mort. Cuba doit non seulement être libre, mais elle ne peut plus être asservie.» Les racines du 10 octobre 1868 sont désormais plus profondes. Ce jour-là, Carlos Manuel de Céspedes, à la tête d’un groupe de patriotes, prit les armes pour lancer la lutte pour l’indépendance qui dut attendre le 1er janvier 1959, soit près d’un siècle, pour devenir une réalité pour la nation cubaine.
L’exploit de ce jour, après une décennie, ne se solda pas par un triomphe. Ce ne furent pas les armes espagnoles qui causèrent l’échec, mais plutôt les divisions internes des patriotes, leur manque d’unité. Le 15 février 1878, le honteux pacte de Zanjón fut signé, abandonnant à l’Espagne les aspirations indépendantistes de plusieurs chefs militaires cubains.
Mais le 15 mars de la même année, Antonio Maceo, avec sa virulente protestation de Baraguá, établit pour les Cubains et pour la puissance coloniale : « Il y avait des patriotes mécontents qui n’acceptaient ni la capitulation ni la paix sans l’indépendance pour laquelle ils s’étaient battus pendant dix longues années.»
Cependant, les forces révolutionnaires avaient La lutte s’affaiblit et une pause – qualifiée de trêve fructueuse par José Martí – fut nécessaire pour réorganiser la lutte.
Le 24 février 1895, sous la direction de José Martí lui-même, la révolution initiée à La Demajagua par Carlos Manuel de Céspedes reprit. Cette guerre ébranla la puissance militaire, politique et économique espagnole à Cuba et démontra la force de l’unité qui avait surmonté les obstacles de la Première Guerre d’Indépendance.
L’Espagne, déjà vaincue, ne parvint pas à maintenir Cuba comme colonie. C’est alors, en 1898, que les États-Unis intervinrent dans le pays, compromettant l’indépendance et la liberté pour lesquelles les Cubains s’étaient battus pendant trente ans.
À la suite de cette intervention, décrite par Vladimir Ilitch Lénine comme la première guerre impérialiste de l’histoire de l’humanité, Cuba cessa d’être une colonie espagnole pour devenir une néocolonie des États-Unis. Le pays fut lié aux visées d’un impérialisme naissant.
Ainsi, le 20 mai 1902, une indépendance irréelle fut proclamée. Pour mettre fin à l’intervention militaire, les Cubains durent accepter l’amendement Platt, qui, entre autres, accordait aux États-Unis le droit d’intervenir à Cuba chaque fois qu’ils le jugeaient approprié, tout en accordant à ce pays le pouvoir d’établir des bases navales – ainsi naquit Guantánamo, toujours illégalement occupée – et d’autres privilèges officialisant l’indépendance proclamée.
Les États-Unis usurpèrent ainsi le pouvoir des Cubains tout en proclamant au monde le mensonge selon lequel ils avaient combattu pour leur liberté.
S’ensuivit une longue période républicaine, marquée par des gouvernements alternants, façonnés à l’image du nouveau pouvoir. Mais les Cubains ne cessèrent jamais de se battre. Chaque génération contribua à la conscience libertaire, et la pensée révolutionnaire continua de s’enrichir.
Des hommes de l’envergure de Julio Antonio Mella, Carlos Baliño, Rubén Martínez Villena, Antonio Guiteras Holmes et bien d’autres ont enrichi l’histoire du combat et perpétué les idées de Carlos Manuel de Céspedes et de José Martí, tous deux tombés lors de la rébellion, tout en nourrissant l’intransigeance d’Antonio Maceo et son héritage de ne jamais céder à l’ennemi.
Le 26 juillet 1953, un groupe de jeunes combattants révolutionnaires, mené par Fidel Castro, attaqua les casernes Moncada à Santiago de Cuba et Carlos Manuel de Céspedes à Bayamo. Cet exploit marqua le début de la dernière étape de la lutte du peuple cubain pour la liberté et l’indépendance. On peut dire que les soulèvements de 1868 et 1895 reprirent et se poursuivirent.
Cette nouvelle action révolutionnaire eut le mérite d’établir Fidel Castro comme leader incontesté de la Révolution, d’instaurer la lutte armée comme méthode pour renverser la tyrannie et d’esquisser un programme de lutte contre la tyrannie. Après la victoire, des revendications pour faire face aux maux du pays furent formulées, tout en rassemblant le peuple autour de cet objectif. L’attaque de la Moncada fut un échec militaire, mais elle constitua une victoire politique d’une importance capitale pour la lutte future.
Après la Moncada, les révolutionnaires subirent l’emprisonnement, la persécution, les assassinats, la prison et l’exil. Une autre trêve fructueuse, telle que décrite par José Martí.
Le 2 décembre 1956, Fidel Castro, accompagné de 81 autres membres de l’expédition, arriva sur la côte est de Cuba pour reprendre la lutte armée. Il établit sa base d’opérations dans la Sierra Maestra, développa la guérilla, forgea une armée rebelle combative, étendit la lutte aux plaines et aux villes et, le 1er janvier 1959, vainquit la tyrannie de Batista. La Révolution, commencée le 10 octobre 1868, avait finalement triomphé après près d’un siècle de luttes et d’immenses sacrifices.
Pour les Cubains, ce 10 octobre n’est donc pas seulement le récit d’un événement historique, mais surtout un engagement en faveur de la continuité d’une œuvre forgée par de nombreuses générations, de l’ignominieuse période coloniale au socialisme victorieux d’aujourd’hui.
Cette histoire de luttes, ces traditions combatives, expliquent la position inébranlable des Cubains face à leur liberté et à leur indépendance. De Céspedes, le Père de la Patrie, nous avons appris que l’ennemi ne peut nous paraître grand que si nous nous habituons à le voir à genoux ; de José Martí, nous avons hérité que les grands droits ne s’achètent pas avec des larmes, mais avec du sang ; Antonio Maceo nous a appris que mendier ses droits est le propre des lâches incapables de les exercer, et il nous a inculqué l’idée de ne jamais conclure de pactes indignes avec l’ennemi. Fidel nous a enseigné le principe selon lequel l’île doit d’abord sombrer dans la mer avant que nous acceptions d’être les esclaves de qui que ce soit.
Ainsi, le 10 octobre 1868 et aujourd’hui se résument aux cris de « Liberté ou la mort ! » et « Indépendance ou la mort ! » de nos exploits libérateurs passés, et aux « Patrie ou la mort ! » et « Socialisme ou la mort ! » du présent. Car à Cuba, selon Fidel, il n’y a eu qu’une seule Révolution : celle initiée le 10 octobre 1868 par Carlos Manuel de Céspedes, et que notre peuple poursuit aujourd’hui victorieusement.
Source Sierra Maestra