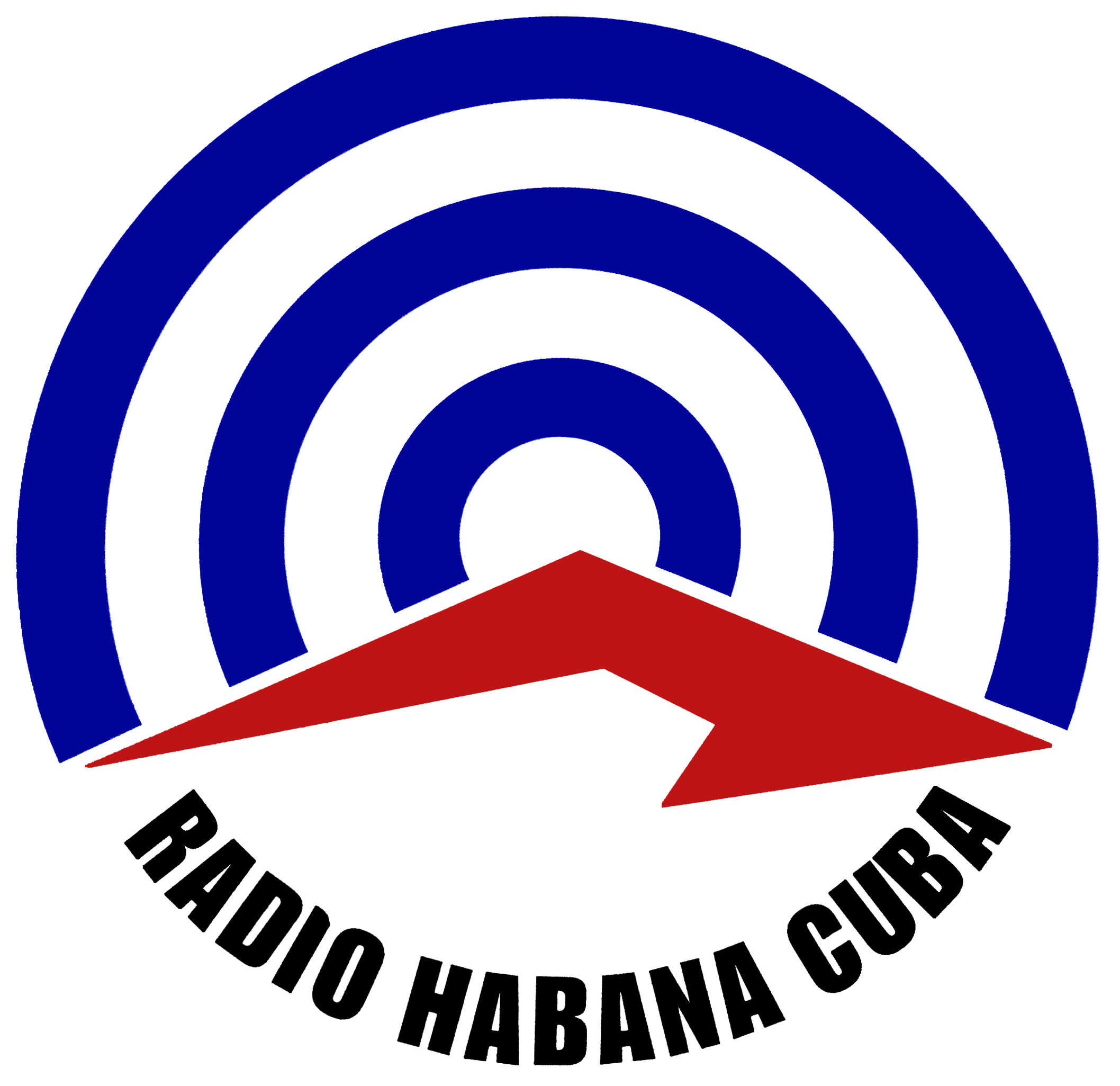Il faut reconnaître que l’une des caractéristiques de l’administration actuelle de Donald Trump dans sa gestion de l’« information » est la création constante de contenus redondants, semant le doute, faisant circuler des torrents de fausses données et, de toute évidence, compliquant l’analyse. Par conséquent, comme dirait un photographe expert, on comprend mieux ce qui se trouve devant l’objectif si, au lieu de zoomer sur le sujet, on prend du recul et qu’on considère les détails qui ne sont généralement pas révélés lorsqu’on examine l’image image par image.
Il est primordial pour toute personne responsable d’observer avec la plus grande inquiétude ce qui se passe au Venezuela et dans ses environs. Les États-Unis élaborent un plan progressif contre ce pays frère, privilégiant les pressions de toutes sortes pour tenter de briser l’Alliance civique et militaire bolivarienne en son cœur même et, à terme, de mener des opérations militaires mal conçues contre le pays. Mais essayons d’analyser ce processus en le mettant en parallèle avec d’autres « actualités » apparemment sans lien, qui, au final, peuvent nous rapprocher de ce que nous appelons la réalité.
Face à la pression croissante exercée sur Caracas, l’amiral Alvin Holsey, commandant du Commandement Sud des États-Unis, a démissionné le 17 octobre, un peu plus d’un an après sa nomination. Il est rare qu’une personne d’origine africaine se voie confier une responsabilité d’une telle ampleur, ce qui rend sa décision (et celle de son entourage) de quitter son poste d’autant plus difficile. Plusieurs hypothèses ont été avancées, mais la plus objective semble être que cette décision découle des désaccords de l’amiral avec les actions militaires déjà menées contre des civils innocents de diverses nationalités au large des côtes vénézuéliennes. Le fait qu’un officier supérieur (et son état-major) ait décidé de ne pas entrer en guerre avant même qu’elle ne commence est un événement significatif.
Au milieu de cette période de turbulences, une information apparemment passée inaperçue ces derniers temps est la mise en examen (17 octobre) de l’ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, pour possession présumée d’informations classifiées. Il affirme avoir utilisé ces informations pour exposer publiquement les dysfonctionnements de la première administration Trump – une opération qui ne requiert pas de données aussi sensibles. Or, Bolton était le principal artisan de toute la campagne anti-vénézuélienne (et anti-cubaine) orchestrée par Trump en 2018 et 2019. Il est apparemment tenu responsable du fiasco du soi-disant Groupe de Lima, du vol massif d’actifs vénézuéliens et de la mise en place du « package Guaidó », que Trump n’a jamais pleinement adhéré, considérant le manque de leadership de Guaidó et de son entourage.
D’autres éléments clés qui se dégagent de ce tableau, et qu’il convient d’examiner, proviennent de l’analyse de la situation en Amérique du Sud. Le président américain n’a pas tardé à lancer des attaques personnelles contre le président colombien Gustavo Petro, qui doit bientôt quitter le pouvoir et vient de superviser la désignation de son successeur au sein de son parti. Les agissements offensifs de Trump visent clairement à influencer les élections à venir et à diviser les forces progressistes du pays.
La Colombie partage une frontière avec l’Équateur, pays en proie à une profonde crise politique dont l’issue est incertaine. Plus au sud se trouve le Pérou, une nation qui n’a pas échappé à un cycle critique ayant entraîné une succession importante de présidents en peu de temps. Peut-on imaginer qu’un soulèvement militaire majeur sur la côte caraïbe de l’Amérique du Sud n’aurait pas un effet domino sur toute la région ? Sans même parler de la situation en Bolivie, qui vient de tenir des élections ayant porté au pouvoir une force politique déterminée à démanteler tous les progrès sociaux réalisés ces dernières années par les gouvernements Morales-Arce.
Sur la scène internationale, Trump reste amer de ne pas avoir pu ajouter le prix Nobel à son palmarès, prix qu’il a perdu face à celui-là même qui a succédé à Juan Guaidó au Département d’État. Trump pensait que cette reconnaissance lui serait acquise grâce à un prétendu cessez-le-feu en Palestine, un cessez-le-feu qui s’est depuis effondré, un échec qui a clairement démontré la collusion de Washington avec Tel-Aviv. La plupart de ceux qui ont soutenu cette mascarade (un grand nombre de pays arabes) voient désormais l’État d’Israël s’arroger le droit de poursuivre des massacres ciblés, et une paix durable semble de plus en plus improbable.
La situation a changé.