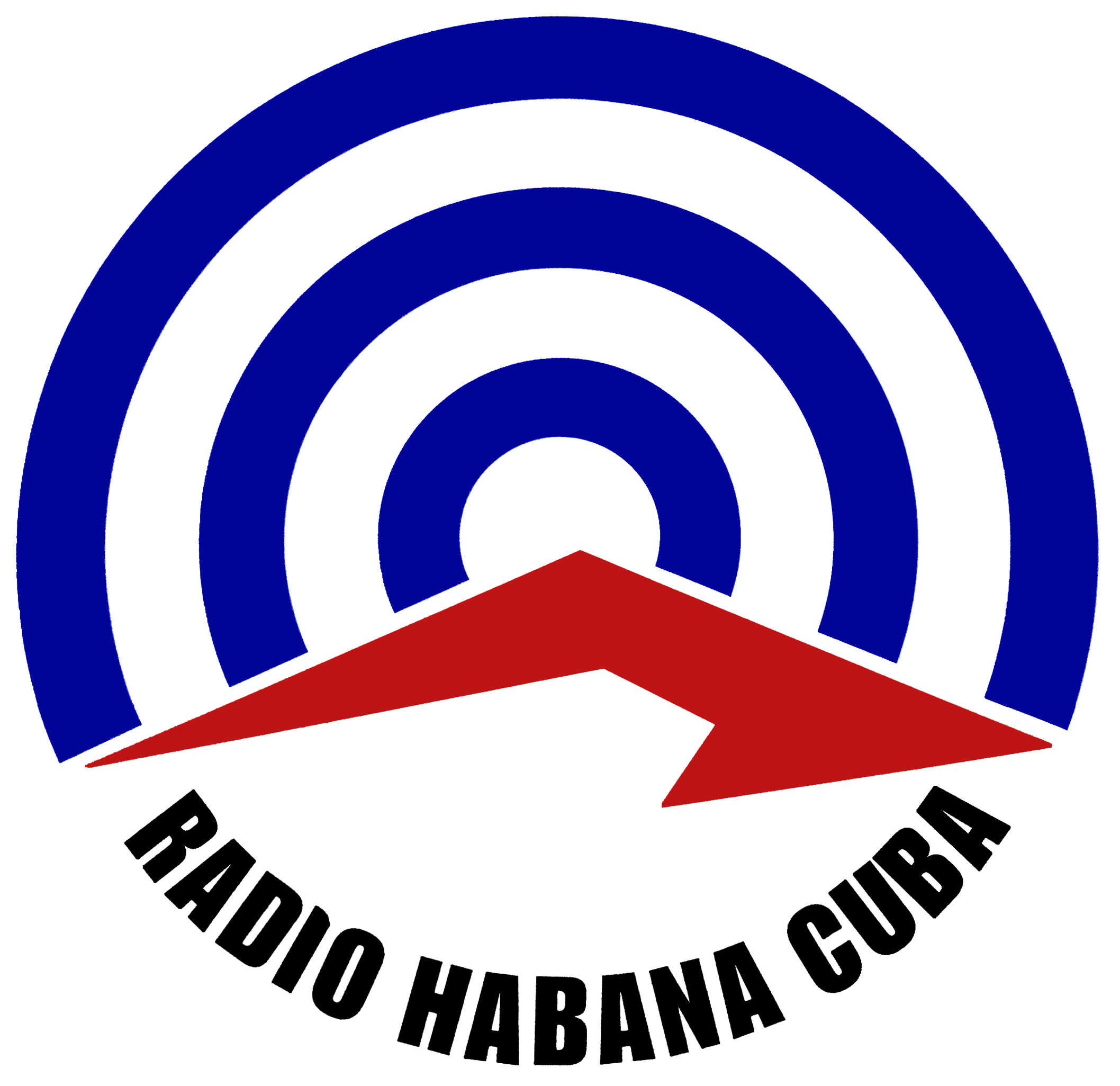Par : Jorge Elbaum
Le major-général du Corps des Marines, Smedley Butler, fut l’un des trois officiers militaires les plus décorés de l’histoire des États-Unis. Il reçut deux médailles d’honneur, la plus haute distinction militaire pour acte d’héroïsme au combat. Après sa retraite en 1931, il publia un essai intitulé « La guerre est un vol ». Quatre ans plus tard, en novembre 1935, il publia un article dans le New York Times intitulé « J’ai peut-être donné quelques indices à Al Capone ». Dans cette tribune, Butler déclarait : « Après trente ans et quatre mois de service chez les Marines, j’ai le sentiment d’avoir agi durant tout ce temps comme un bandit de haut vol au service des grandes entreprises de Wall Street et de leurs banquiers… En un mot, j’étais un gangster au service du capitalisme… J’ai été récompensé par des honneurs, des médailles et des promotions. Mais avec le recul, je me dis que j’aurais pu donner quelques conseils à Al Capone. Lui, en tant que gangster, opérait dans trois quartiers d’une seule ville. Moi, en tant que Marine, j’opérais sur trois continents. »
La géopolitique s’est imposée comme discipline en s’appuyant sur les réminiscences historiques. Ses analystes sont constamment en dialogue avec les événements passés : ils les imitent, les rejettent ou les adaptent. Mais ils tiennent toujours compte des précédents pour adapter leurs enseignements au présent. Actuellement, les États-Unis actualisent ces références. Tout en s’empressant de redéfinir la configuration de l’Amérique latine et des Caraïbes, elle refuse de reconnaître les profonds changements structurels survenus dans la région du fait de son déclin économique relatif. Depuis le début du XIXe siècle, la doctrine Monroe s’est d’abord appuyée sur la diplomatie de la canonnière, puis sur la politique du « gros bâton ». Ces deux approches se sont ensuite combinées pour donner naissance à la doctrine de sécurité nationale et aux disparitions forcées, érigées en pratique de terrorisme d’État.
Son objectif stratégique a été, pendant deux siècles, de contrôler les gouvernements de la région afin d’accéder à leurs ressources naturelles sans réglementation préalable. Désormais, elle y a ajouté la nécessité d’empêcher toute coopération symétrique avec les membres du BRICS+. Pour atteindre ces deux objectifs, elle doit empêcher toute manifestation de souveraineté, qu’elle soit politique, commerciale ou productive. L’offensive militaire contre le Venezuela, le sabordage de barges dans le Pacifique colombien, l’ingérence dans les élections argentines, les opérations secrètes au Honduras, au Chili et en Colombie – visant à installer des présidents à leur solde comme Javier Milei – et la criminalisation politique de figures populaires (Fernando Lugo, Manuel Zelaya, Jorge Glas, Pedro Castillo, Evo Morales, Lula, Cristina Kirchner, Julio de Vido) s’inscrivent dans un même plan d’intervention sur le sous-continent indien. Il s’agit d’une tentative brutale de remodeler la région et de l’intégrer à une sphère d’influence unique, opposée au Sud global et menée par la République populaire de Chine et la Fédération de Russie. Pékin est le principal antagoniste car la Chine est devenue l’usine la plus productive et compétitive au monde. Moscou, quant à elle, refuse de se soumettre aux 32 pays membres de l’OTAN.
Dans ce contexte, le cas de la République bolivarienne du Venezuela apparaît crucial pour l’offensive de Washington. D’une part, Caracas possède les plus importantes réserves de pétrole au monde, et ses réserves de gaz se classent au huitième rang mondial. Selon les calculs de l’Agence fédérale d’information sur l’énergie (EIA), les États-Unis disposent de réserves de gaz prouvées équivalentes à douze années de consommation annuelle au niveau actuel. L’autre facteur alimentant la guerre psychologique et l’intimidation militaire est lié à l’exemple pernicieux donné par le chavisme, qui défend sa souveraineté grâce à des forces armées bolivariennes fidèles au mandat anti-impérialiste transmis par Hugo Chávez. Le troisième élément concerne le renforcement des relations de Caracas avec les BRICS+, qui exclut Washington comme partenaire potentiel pour la croissance présente et future du Venezuela. Afin de garantir son contrôle politique – et l’accès à ses ressources –, Washington s’obstine à briser le chavisme, car ce dernier est devenu un symbole de souveraineté régionale pour le reste du sous-continent. Un bien mauvais exemple, en effet.
Le prétexte de la guerre contre la drogue masque l’intention de provoquer un changement de régime. Pour ce faire, la Maison Blanche envisage diverses options fondées sur la guerre psychologique, soutenue par l’étalage ostentatoire d’une force navale qui exhibe quotidiennement sa puissance de feu depuis des barges non armées. Cette démonstration de force militaire inclut la présence intimidante du porte-avions considéré comme le plus puissant au monde, le Gerald Ford, dont l’efficacité est pourtant limitée face aux trafiquants de drogue potentiels déployés à l’est et à l’ouest du Panama. La couverture médiatique quotidienne des bombardements contribue à rendre la militarisation acceptable et naturelle.
Sur la base de ce déploiement, le plan de Marco Rubio comprend sept options interconnectées, alternées et/ou se chevauchant : (a) Le déclenchement d’un coup d’État interne, orchestré et financé par des opérations secrètes de la CIA, autorisées par Trump il y a un mois. (b) La création d’une situation de troubles sociaux internes qui permettrait une intervention militaire humanitaire. (c) Tenter d’assassiner le président Nicolás Maduro ou un haut responsable des Forces armées bolivariennes afin de légitimer un vide du pouvoir. (d) Tenter d’enlever certains de ces responsables en utilisant la Delta Force de l’armée de terre ou le commando SEAL Team 6 de la marine. (e) Lancer des attaques de missiles contre des sites stratégiques et/ou des installations militaires, similaires à celles menées contre la République islamique d’Iran en juin dernier. (f) Une invasion limitée visant à contrôler des puits de pétrole, des aéroports ou des installations radar, comme ce fut le cas en Libye et en Syrie. (g) Une invasion à grande échelle, qui nécessiterait plus de 150 000 soldats américains. Cette dernière option entraînerait un conflit sur un territoire de près d’un million de kilomètres carrés, favorisant une guerre irrégulière, de profonds bouleversements en Amérique latine et des perturbations mondiales imprévisibles.
De plus, le plan de Rubio omet toute analyse des capacités bolivariennes, notamment celles connues sous le nom de « résistance populaire prolongée et offensive de défense militaire et policière », censées être déployées au sein d’un réseau de vingt mille positions de combat sur l’ensemble du territoire vénézuélien. Il y a plus de trente ans, Noam Chomsky écrivait : « …le seul moyen pour les États-Unis d’attaquer un ennemi bien plus faible est de lancer une offensive de propagande massive qui le présente comme le mal absolu, voire comme une menace pour notre survie même.» Il faisait référence à l’Irak, mais, dans une logique impériale, les noms des deux pays sont interchangeables.