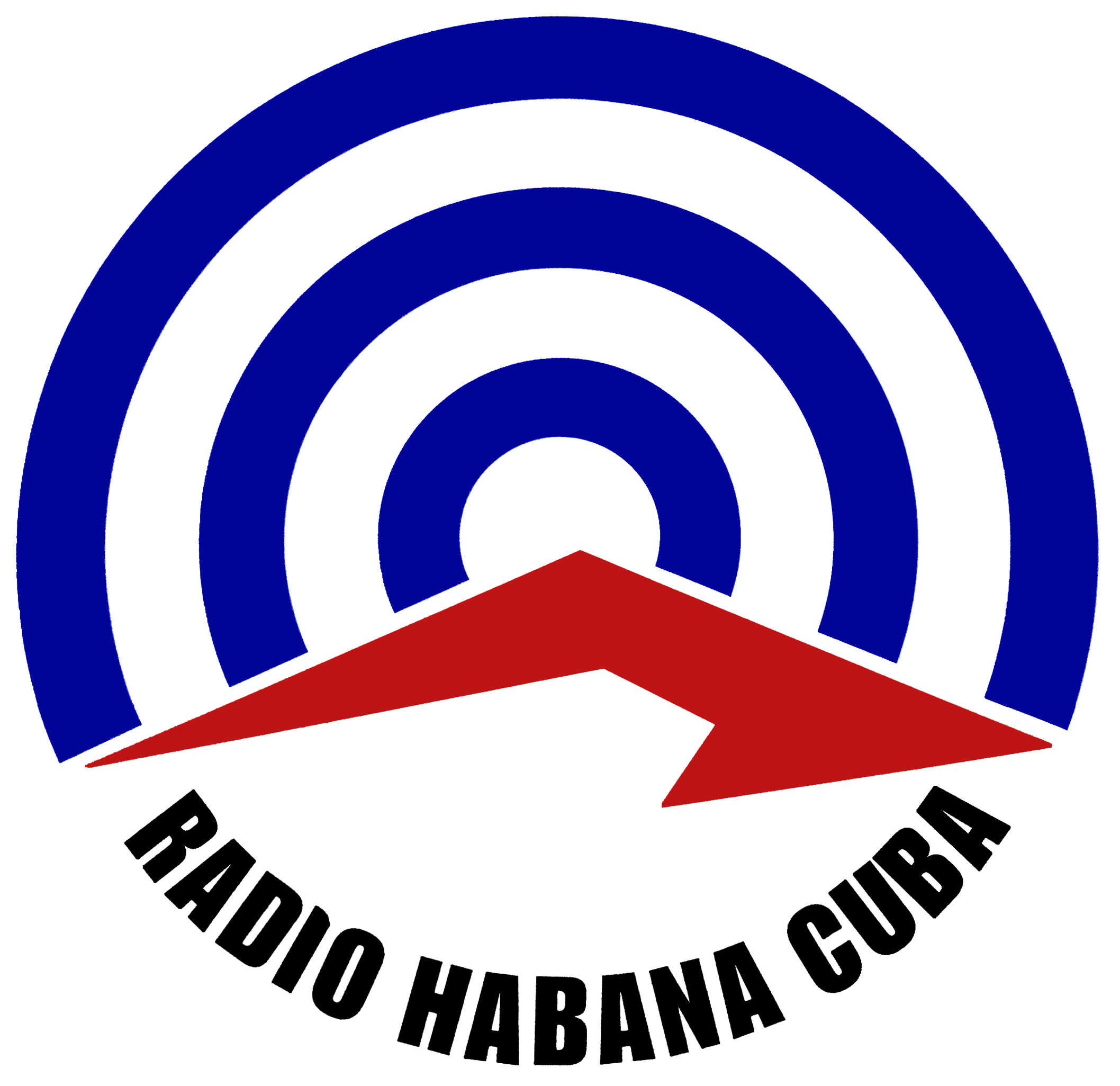La mise en œuvre de la glorieuse Opération Carlota, avec la participation militaire d’internationalistes cubains, a facilité l’indépendance du vaste territoire colonial africain, qui allait devenir la République populaire d’Angola (RPA), le 11 novembre 1975.
Ce fut l’un des événements internationaux les plus marquants de cette année-là, survenu dans un contexte de conflit armé dramatique. Au nord, l’invasion était soutenue par le gouvernement du Zaïre (actuelle République démocratique du Congo), appuyé par des mercenaires sous la supervision de la CIA, tandis qu’au sud, l’armée régulière de l’Afrique du Sud de l’apartheid menait l’offensive.
La déclaration d’indépendance fut menée par le président du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), qui devint plus tard président de la République, le Dr Antonio Agostinho Neto, médecin et poète de renom de sa génération, engagé non seulement dans la libération de son pays, mais aussi de toute l’Afrique australe, et plus particulièrement après son accession à la tête de l’État angolais.
Un demi-siècle nous sépare de cet événement historique, qui a mis en lumière la capacité du gouvernement révolutionnaire cubain à soutenir le MPLA dans sa longue et non moins complexe lutte, depuis sa fondation le 10 décembre 1956 jusqu’à nos jours, en tant que parti au pouvoir entretenant des relations officielles avec le PCC. Cuba et l’Angola ont établi des relations diplomatiques le 15 novembre 1975.
L’analyse approfondie du soutien internationaliste apporté par l’Angola et Cuba, présentée par le Commandant en chef lors du premier congrès du PCC en décembre 1975, a souligné la portée et l’importance de cette épopée internationaliste, dont le moment emblématique fut la rencontre à Brazzaville (janvier 1965) entre le commandant Che Guevara et Neto.
Un bref aperçu de l’évolution et du développement ultérieur du MPLA révèle que c’est le mouvement de libération nationale angolais qui a compris la nécessité de l’unité et de la cohésion, de Cabinda à Cunene, comme un pilier essentiel. Elle a pris en compte l’incontournable réalité d’un paysage ethnolinguistique et culturel diversifié et a articulé une activité politique axée sur la sensibilisation et le renforcement de l’engagement, ainsi que sur la mobilisation pour la lutte armée.
À cela, il faut ajouter le caractère révolutionnaire et progressiste que le président Neto et ses plus proches collaborateurs – certains membres du Bureau politique naissant et d’autres du Comité central du MPLA, organisé en août 1974 – ont insufflé aux actions du mouvement.
Parallèlement, la création des Forces armées populaires de libération de l’Angola (FAPLA) a constitué une autre décision cruciale, leur permettant de défendre le pays et de faire face à la guerre imposée par des ennemis intérieurs et extérieurs, menés par les États-Unis, au plus fort de la Guerre froide. L’hostilité manifeste de Washington est restée intacte jusqu’à la signature des accords de New York le 22 décembre 1988.
Ces accords ont révélé une facette particulière du développement des relations bilatérales entre Cuba et la République populaire d’Angola (RPA), notamment dans les domaines politique et diplomatique. Ils ont permis à Cuba, face aux États-Unis et à l’Afrique du Sud de l’apartheid, de garantir l’intégrité territoriale de l’Angola et d’établir un calendrier pour l’indépendance de la Namibie.
C’est durant cette période que se déroula la bataille cruciale de Cuito Cuanavale, dans le sud-est de l’Angola. Cette bataille porta le coup de grâce au régime d’apartheid et catalysa des changements internes en Afrique du Sud, menant au démantèlement du système oppressif de racisme institutionnalisé et de ségrégation raciale, ainsi qu’aux premières élections multipartites et multiraciales, tenues fin avril 1994.
Les liens d’amitié et de solidarité qui unissent Cuba et l’actuelle République d’Angola reposent non seulement sur la conduite consensuelle des relations politiques et diplomatiques, mais aussi sur une coopération bilatérale, particulièrement importante dans le domaine social pour l’Angola. Par ailleurs, le soutien apporté par Luanda à la noble cause de Cuba, à savoir la lutte contre le blocus américain, a été fondamental.
En conclusion, il convient de souligner que l’opération Carlota a marqué un tournant dans l’internationalisme militaire cubain, s’appuyant sur un précédent africain crucial, comme en témoigne l’expérience de ce type en Guinée-Bissau. Pendant plusieurs années, les colonialistes portugais y furent vaincus par la puissance de feu redoutable des guérilleros guinéens et de leurs collaborateurs cubains.
Lors de cette bataille décisive en Guinée, d’éminents chefs des montagnes et des plaines y participèrent, notamment les commandants Raúl Menéndez Tomassivitch et Raúl Díaz Argüelles, tous deux Héros de la République de Cuba, et Víctor Dreke, commandant en second du contingent internationaliste cubain en République démocratique du Congo, dirigé par l’inoubliable commandant Ernesto Guevara de la Serna.
(Rodobaldo Isasi, chercheur au Centre de recherche en politique internationale – CIPI -)