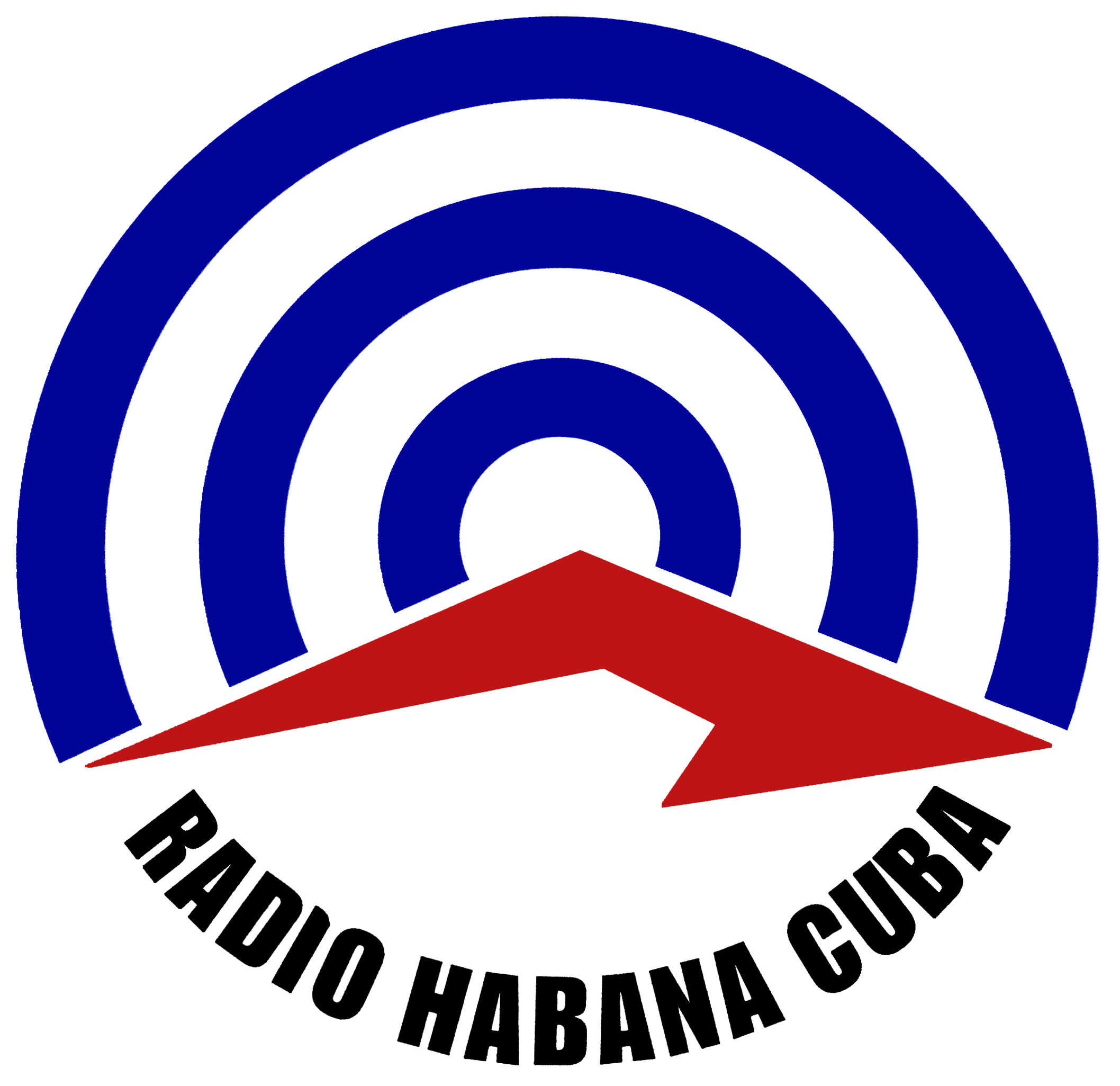Pirates des Caraïbes
Par : Jorge Elbaum
Donald Trump part du principe qu’il ne peut pas l’emporter dans une guerre contre la Fédération de Russie. C’est la véritable raison pour laquelle il abandonne l’Europe occidentale à son sort. Il n’a pas non plus réussi à soumettre la République populaire de Chine sur le plan géopolitique. Les négociations commerciales que ses représentants mènent avec Pékin à Madrid ne reflètent pas la capitulation que l’ancien magnat devenu président a prônée au début de son second mandat. Dans la vision trumpiste du monde, les États-Unis doivent se considérer comme vainqueurs d’une guerre. La mégalomanie trumpiste ne peut se manifester sans soumettre d’autres peuples. Il se sent obligé d’offrir à ses partisans suprémacistes l’image d’une puissance que la multipolarité commence à ébranler.
La nouvelle piraterie caribéenne a été déployée pour faire pression, intimider et menacer la République bolivarienne du Venezuela, avec l’objectif stratégique de créer les conditions nécessaires à la conquête des plus grandes réserves mondiales de pétrole. Pour atteindre cet objectif, Washington recourt à la figure du narcoterrorisme, avertissant le reste du monde que l’hémisphère occidental – son prétendu arrière-cour – demeure une possession exclusive. Les États-Unis sont le plus grand consommateur d’énergie fossile au monde. Selon les estimations officielles, leurs réserves dureront environ quinze à vingt ans. Washington extrait une grande partie de ces ressources énergétiques par fracturation hydraulique, une technique coûteuse comparée au forage vertical ou horizontal. Le Venezuela, quant à lui, possède les plus importantes réserves prouvées d’hydrocarbures, estimées à 300 milliards de barils, surpassant celles de l’Arabie saoudite.
Conformément à ses plans de guerre hybride, Washington a déployé deux mécanismes parallèles de pression et d’intimidation, s’inscrivant dans la vieille alternance de la carotte et du bâton. D’un côté, le chef belliqueux du département d’État, Marco Rubio, est chargé d’attiser la menace de guerre. De l’autre, celui mené par l’envoyé spécial de Trump, l’ancien membre de la CIA Richard Grenell. Ce dernier insiste sur le fait que la guerre peut être évitée par des accords diplomatiques, tandis que le premier ordonne le déploiement d’une flotte militaire à la frontière caribéenne.
Selon des spéculations rapportées par le New York Times, Grenell a affirmé dans un rapport qu’une invasion du Venezuela était impossible, compte tenu de sa géographie, de la capacité de réponse militaire du chavisme et du conflit qu’elle engendrerait en Amérique latine et dans les Caraïbes. Dans ce rapport, non encore déclassifié, Grenell a déclaré que toute offensive militaire : a) renforcerait le chavisme ; b) susciterait une vague d’unité interne face à l’agression ; c) ferait du Venezuela un pays attaqué, suscitant ainsi la solidarité au sein de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) ; et d) contribuerait à consolider les liens de la région avec Pékin et Moscou.
Une invasion militaire nécessiterait, soulignent les analystes du Pentagone, un nombre de troupes que la situation politique interne actuelle des États-Unis ne pourrait pas supporter. Selon l’analyste Christopher Sabatini, chercheur au groupe de réflexion britannique Chatham House, « personne sensé ne peut imaginer que 4 500 marines puissent envahir un pays composé de montagnes, de jungle et de multiples centres urbains.» L’invasion du Vietnam à la fin des années 1960 a nécessité 450 000 soldats pour un territoire de 332 000 kilomètres carrés. L’incursion de 1989 au Panama a nécessité 30 000 hommes en uniforme pour 75 000 kilomètres carrés. L’invasion de l’Irak a nécessité environ 160 000 hommes en uniforme pour 440 000 kilomètres carrés. Envahir un territoire de plus de 900 000 kilomètres carrés, avec une géographie comprenant des montagnes et des jungles, nécessiterait un nombre supérieur à celui des hommes en uniforme déployés en Irak. De plus, cela transformerait l’Amérique latine et les Caraïbes en un brasier continental.
Actuellement, Trump ne dispose que de quatre marionnettes au gouvernement : Nayib Bukele au Salvador, Daniel Noboa en Équateur, Santiago Peña au Paraguay et Javier Milei en Argentine. Ces trois derniers perdent progressivement de leur popularité, tandis que Claudia Sheinbaum et Lula da Silva, clairement opposés à toute intervention militaire, comptent parmi les dirigeants les plus respectés. En coulisses, les autres présidents remettent en question toute velléité d’intervention, tant par souci de souveraineté que par les conséquences de la déstabilisation intérieure qu’elle entraînerait. Ce défi renforce l’opinion dominante au sud du Rio Grande quant aux pratiques racialisantes douteuses des autorités.
Actuellement, Trump ne dispose que de quatre marionnettes au gouvernement : Nayib Bukele au Salvador, Daniel Noboa en Équateur, Santiago Peña au Paraguay et Javier Milei en Argentine. Ces trois derniers connaissent une baisse progressive de leur popularité, tandis que Claudia Sheinbaum et Lula da Silva, clairement opposés à toute intervention militaire, comptent parmi les dirigeants les plus respectés. En coulisses, les présidents restants remettent en question toute velléité d’intervention, tant au nom des principes de souveraineté que de la déstabilisation intérieure qui en résulte. Ce défi renforce l’opinion dominante au sud du Rio Grande concernant les pratiques racialisantes douteuses des autorités d’immigration aux États-Unis. Si l’on ajoute à cela la prolifération de discours xénophobes propagés par les puissances du mouvement MAGA, on peut décrire la situation comme une guerre ouverte contre tous les Latino-Américains et les Caribéens.
Face à cette réalité, des réalignements logiques sont en cours. La semaine dernière, l’Assemblée nationale vénézuélienne a approuvé le Traité de partenariat stratégique et de coopération avec la Fédération de Russie. Ce traité renforcera la collaboration militaire, qui a déjà conduit à l’ouverture de la première usine de Kalachnikov dans la région de Maracay, en partenariat avec l’entreprise publique russe Rosoboronexport, pour la production de 70 millions de cartouches par an pour les fusils d’assaut AK 103. Les accords avec Moscou ont également permis le développement conjoint de systèmes de navigation par satellite (GPS) alternatifs, indépendants de ceux manipulés par les États-Unis.
Caracas dispose actuellement du système russe Glonass, qui permet une géolocalisation indépendante de la surveillance du Commandement Sud.
Les mouvements de corsaires dans les Caraïbes ont également suscité des déclarations de hauts responsables de la République populaire de Chine. Son ministre de la Défense, Dong Jun, qui s’exprime rarement en public, a exhorté à ne pas accepter la logique interventionniste : « …la mentalité de la guerre froide ne s’est pas encore dissipée… La mémoire historique doit servir d’avertissement constant pour reconnaître et s’opposer à la logique hégémonique et aux actes d’intimidation déguisés en de nouvelles formes.» Dong a également souligné que la puissance du Sud global est « invincible, insufflant une force motrice à l’histoire », et a promis une coopération avec ces pays en matière de sécurité.
En 1961, ils ont échoué lors de l’invasion de la Baie des Cochons à Cuba. Dans les années 1970, ils ont imposé le Plan Condor par le feu et le sang. Dans les années 1980, ils ont financé les Contras nicaraguayens et encouragé le génocide au Guatemala. En 1983, ils ont envahi la Grenade et, en 1989, le Panama. Bien que cette phrase ait été répétée ad nauseam, il sera toujours nécessaire de la mémoriser : « Les États-Unis semblent destinés par la Providence », a écrit Simón Bolívar, « à affliger l’Amérique de misère au nom de la liberté.»
(Tiré de Página 12)